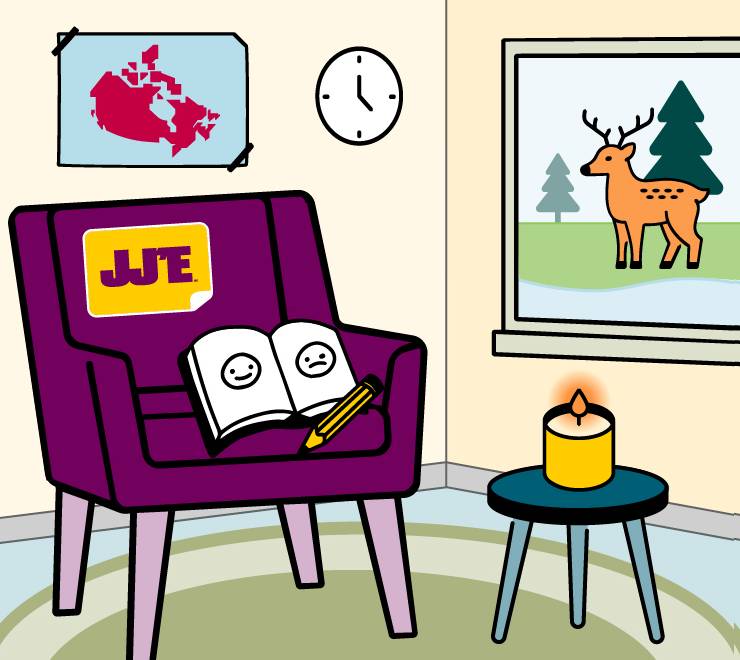Cette histoire a été écrite par Danai Mushayandebvu, spécialiste de la commercialisation de marques sur les médias sociaux, auteure et militante pour la santé mentale.
Illustrations de Jennifer Chan
Ma famille a immigré au Canada lorsque je n’avais que 13 ans. Je suis née au Zimbabwe et j’ai vécu huit ans au Botswana, avant d’atterrir à l’aéroport Pearson de Toronto par une froide nuit d’hiver. À 13 ans, tout semble être une grande aventure. Mes parents nous ont expliqué, mes frères, mes sœurs et moi, que nous allions refaire notre vie dans ce beau pays, une existence qui promettait d’être magnifique et libre. Même si j’étais triste de quitter la seule vie que je connaissais, je savais que peu importe ce qui nous attendait au Canada, nous nous en sortirions, car nous étions ensemble.
S’adapter à une nouvelle vie
Pendant les premières semaines à ma nouvelle école secondaire, dans un quartier de Mississauga très diversifié, mais quand même très blanc, mon ancienne vie et mes anciens amis me manquaient. Le froid qui régnait au Canada me perturbait (en fait, je suis encore sous le choc), et j’avais toujours l’impression d’être mise de l’avant pour être isolée et piquée en tant que « nouvelle fille arrivant de l’Afrique ».
Les gens me faisaient des commentaires du genre :
« Mais tu parles si bien l’anglais! »
« Et qu’en est-il de cette langue, avec les claquements sonores? Tu es capable? »
« Puis-je toucher tes cheveux? »
« Tu connais N*Sync? »
« Check-moi l’outfit. Ça vient de BOTSwana? »
Les gens ont été surpris de voir que j’étais si bien adaptée, au courant de la culture populaire, et que je m’exprimais si bien. J’ai fait voler en pièces tous les stéréotypes liés au fait d’être « une pauvre Africaine » sur laquelle on pouvait s’attrister dans ces publicités de parrainage d’enfant. La réalité, c’est que j’ai fréquenté certaines des meilleures écoles internationales, que j’ai beaucoup voyagé et qu’on m’a même demandé de donner des cours d’anglais lorsque j’ai commencé l’école au Canada, parce que mon niveau était plus élevé que le reste de ma classe. Mes parents ont choisi de s’établir au Canada non pas par désespoir, mais pour nous permettre, leurs enfants, de tirer le meilleur parti possible de notre vie. C’est une promesse que l’immigration fait souvent, mais qu’elle tient rarement, comme je l’apprendrais bien assez vite.
Apprendre à naviguer mon identité
Avec les années, les souvenirs que j’avais de mon enfance se sont estompés. Comme je n’avais que mes parents, mes frères et mes sœurs pour combler les vides de ma mémoire, je me suis souvent demandé ce qui était réel et ce que j’embellissais lorsque je racontais mes histoires. Au fur et à mesure que je grandissais, chaque question posée me semblait moins être de l’intérêt, mais plus comme une séance d’interrogation assez invasive sur mon vécu. Pour échapper à l’inconfort d’être reconnue comme une « autre », et pour compenser les difficultés rencontrées par mes parents, j’ai par inadvertance désappris mon identité Africaine. J’ai perdu l’accent que j’avais depuis toujours. Même si le fait de parler comme mes pairs calmait mon anxiété, en y repensant maintenant, je réalise que c’était ma réaction à un traumatisme.
Malgré le désarroi que je ressentais parfois, j’ai toujours été très appréciée à l’école et dans mes emplois à temps partiel. Je détestais cette attention injustifiée qui me mettait mal à l’aise. J’ai été instrumentalisée en tant que « fille Noire », et j’ai encaissé des commentaires du genre : « Je ne suis jamais sortie avec une fille Africaine avant, je me demande comment c’est » ou « tu es vraiment jolie pour une fille à la peau foncée ». Je faisais de grands sourires en entrant dans un magasin, lorsque d’emblée, on me jugeait coupable à l’avance de vol. Je ne me vengeais pas afin de ne pas perpétuer le trope de la « femme Noire en colère ».
J’ai souvent pensé être en guerre avec moi-même. J’avais l’impression que je n’étais pas vraiment appréciée pour être Danai, mais plutôt pour la représentation caricaturale, de ce que les gens pensaient que je « devrais » être. Pourquoi cette nouvelle vie, peinte comme étant tellement meilleure, était-elle si difficile? Je me suis souvent demandé comment ma vie serait si j’étais venue au monde au Canada, si je ressemblais aux gens autour de moi, si je parlais comme eux, si je me comportais de la même façon. M’aimeraient-ils quand même? Parfois, je n’en étais même pas certaine. J’étais si confuse que je me demandais où était ma place. Je me sentais comme une boîte à cocher. Un quota devant être rencontré.
Un désir de m’assimiler
La diversité est promue et largement reconnue au Canada, pays qui continue à donner un exemple remarquable en accueillant des réfugiés et des immigrants afin qu’ils puissent reconstruire leur vie. Malgré tout, il est plus facile de se fondre dans la masse lorsque la couleur de votre peau n’est pas « de couleur ». Une de mes amies a émigré du Pérou au Canada au même âge environ que moi. Bien que le fait de s’installer ici et de s’adapter à une nouvelle culture furent difficiles pour elle, elle a, avec chagrin, admis être souvent soulagée que ses traits caucasiens (cheveux blonds et yeux bleus) dissimulaient son altérité. Entendre des conversations controversées aux dépens des immigrants l’attriste, mais elle ne dit rien, car s’exprimer est parfois trop fatigant et fait trop mal. C’est fatigant, ça, je le comprends. Elle est consciente que me faire demander « D’où viens-tu », uniquement à cause de la couleur de ma peau doit être très frustrant, parce qu’elle ne subit presque jamais (même jamais) ce qu’on appelle des microagressions raciales. Elle n’a jamais besoin de se risquer, elle n’a jamais besoin de s’expliquer.
Ce qui est ironique, c’est que j’adore parler et que j’ai certainement de nombreuses histoires à raconter. J’aime créer des liens avec les gens, j’aime aussi éduquer au sujet de ce que c’est que de naître au Zimbabwe et de vivre au Botswana. Il est difficile de trouver le juste milieu entre essayer de s’intégrer et vouloir partager mon histoire singulière. Il suffit d’un seul commentaire maladroit et sans douceur pour que je redevienne cette jeune fille de 13 ans qui ne voulait pas avoir des cheveux différents, un vocabulaire étendu et une joie de vivre qui s’effritait lentement lorsqu’elle était confrontée aux réalités du monde.
Revisiter mon enfant intérieur
Je rêvais parfois de ma vie d’autrefois, et pendant de nombreuses années, j’ai perçu « Quand je retourne chez moi [Botswana] » comme un symbole de ce moment magique où tout irait bien à nouveau, comme je serais de nouveau chez moi. J’ai voyagé au Botswana il y a quelques années, de retour pour la première fois en 17 ans. J’espérais y trouver une partie de moi qui prouverait que j’appartenais à cet endroit, moi aussi. J’ai visité mon ancienne école primaire et je me suis sentie si grande dans ce lieu qui, lorsque j’étais petite, semblait représenter tout mon monde. Les couloirs familiers et les coins de gazon et de soleil chaud m’ont fait l’effet d’une cérémonie de guérison. J’ai regardé une des nombreuses peintures murales et j’ai eu un souvenir soudain et intense : je me suis souvenue d’y avoir contribué.

Je l’ai examiné, à la recherche de mon nom, de mes initiales, de quelque chose. Et j’ai trouvé. Une partie de moi intégrée dans l’histoire.

Je me souviens du jour où j’ai créé ceci. Quelque chose a cliqué en moi à ce moment-là : mon sentiment d’appartenance n’avait rien à voir avec cet endroit ou avec les moments que je désirais si désespérément retrouver, mais il avait tout à voir avec ma relation avec moi-même. Je pouvais être à la fois Canadienne, Zimbabwéenne, immigrante et Noire. Ce que ça voulait dire, vraiment, c’était que j’appartenais à moi; pas à un endroit, pas à une personne, pas à un moment. Depuis mon arrivée au Canada, et même avant d’être une jeune expatriée au Botswana, je transporte consciemment en moi le sentiment d’être « autre » dans une culture qui n’a rien vu ou rien vécu qui soit véritablement différent. Voilà pourquoi je suis si compatissante aux difficultés de l’immigration, et pourquoi je suis si émue par les histoires identitaires, et pourquoi j’ai tellement envie de les partager. Déménager dans un nouveau pays, une nouvelle ville ou un nouvel endroit, tout en essayant de préserver ce que l’on croit être vrai, mais que les autres ne comprennent pas, est une chose extraordinairement difficile. Je le connais trop bien, ce sentiment.
Faire mienne mon identité
J’essaie de ne pas définir ma valeur dans mon identité de Zimbabwéenne ou Canadienne. Je suis une fière membre de la communauté des PANDC, mais c’est aussi normal pour moi d’exister entièrement en tant qu’être humain. Je mérite d’être respectée et valorisée. Exister à mi-chemin dans la vie signifie que j’ai la liberté de définir celle que je veux vivre tout en gardant en mémoire le parcours effectué par ma famille pour en arriver là où nous sommes. Chaque jour, je décide consciemment d’être bienveillante avec la « Danai-plus-jeune » qui ne savait pas comment réagir. Je décide, au quotidien, de trouver le courage de me défendre et de parler pour les personnes qui m’entourent, en dépit du négatif que j’ai vécu. Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre tout cela.
Lorsque je subis des microagressions (ça m’arrive encore), je ne peux pas m’empêcher de penser à ce que les personnes qui attaquent ne réalisent pas : les commentaires maladroits ou les regards indiscrets sont dommageables, mais ils enlèvent en plus à des parents comme les miens de l’importance aux sacrifices qu’ils se sont imposés pour s’assurer que j’ai le droit de vivre dans le même pays qu’eux. Ma place est ici, parce que je suis un être humain, et pas en raison de mon apparence, de ma voix, de ce que je peux faire pour vous, ou de ma valeur. Tout simplement parce que ma place est ici.
Si tu es aux prises avec un problème – peu importe l’ampleur – tu peux toujours demander de l’aide. Jeunesse, J’écoute est là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Tu peux nous joindre par texto ou téléphone. Nous sommes toujours présents, d’un bout à l’autre du pays.
Jeunesse, J’écoute remercie Danai Mushayandebvu d’avoir partagé cette histoire d’espoir avec les jeunes de partout au pays!
Cet article est une traduction de l’article original en anglais.